Sourire éclatant de Margot Robbie et plus crispé d’un Ryan Gosling qui se fait écraser la figure, paillettes, rayures et palmiers… L’affiche est flamboyante. Difficile d’échapper au phénomène qui colore de rose nos rues et les murs du métro depuis janvier. La sortie tant attendue du nouveau film de Greta Gerwig est enfin arrivée le 19 juillet et deux semaines après Barbie approche le milliard de dollars au box office.
Et pourtant les critiques sont en dents de scie. Si certains saluent un film léger sans être bête, féministe et décomplexé, d’autres lui reprochent de n’être finalement qu’une grosse pub de deux heures pour la marque historique de Barbie, Mattel.
Une vérité entre les deux ? Oui et non. Je ne m’attendais à rien quand j’ai enfilé une mini-jupe (rose) et des bottes de cowboy le 19 juillet avant de rejoindre l’avant-première du film sur les quais de Loire. Je suis pourtant le travail de Greta Gerwig depuis longtemps. Ladybird m’a bouleversé et reste pour moi l’un des plus juste portrait d’une adolescente au cinéma, voir de l’adolescence tout court. Mais là… Je ne sais pas. Les affiches, trop brillantes, trop présentes ? Le fait de savoir dès le départ que le film était une commande de Mattel ? Je n’y allais ni avec envie ni à reculons, curieuse, quand même, mais sans attentes.
Et pourtant je suis sortie du film en colère.

Barbie est avant tout un film très malin. Il y a un vrai plaisir à retrouver l’écriture de Greta Gerwig, épaulée au scénario de son compagnon Noah Baumbach. Les répliques sont étonnamment mordantes, l’humour très adulte, le tout avec un sens du rythme qui, tant qu’il reste à Barbieland, fait mouche. Toute la première partie concentrée sur Barbieland est d’ailleurs la meilleure. Pour ses décors et ses costumes bien sûr, excellent travail de Sarah Greenwood, Katie Spencer et Jaqueline Durran. Mais aussi et surtout pour le plaisir ludique qui s’y déploie.
Tout est jeu, tout est fait « pour de faux ». Pas de miroir. Pas d’eau dans la douche, ni dans les verres, vagues en plastique sur la plage… Comme le petit déjeuner que Barbie fait semblant de manger, la voiture qu’elle fait semblant de conduire ou la maison dont elle s’envole comme si on la « posait là ». Vrai hommage à l’usage du jouet plus qu’au jouet lui-même, le début du film enchaîne les clins d’œil aux enfants que nous étions sans se moquer et avec une joie communicative.
On y a même droit à quelque chose de très décalé et prometteur : Barbie a des pensées liées à la mort et c’est ça qui détruit peu à peu son univers. Promesse scénaristique qui ne sera pas tenue, mais ça, on y reviendra plus tard.
Donc un début coloré et intelligent, mais il est vite temps de quitter Barbieland et à l’entrée dans le vrai monde les choses se ralentissent (et se corsent). Enchaînement de séquences un peu facilement reliées entre elles, le monde des humains est beaucoup plus décevant que son double en plastique et même si c’est (peut-être) voulu, le film y devient visuellement beaucoup moins intéressant.
Le rythme patine un peu. On regarde Barbie et Ken, qui se chamaillent comme des maternelles ce qui donne lieu à des scènes très drôles, découvrir notre réalité et le patriarcat, partout, tout le temps, violent. Épouvante de Barbie et boost d’égo pour Ken, qui comme les autres hommes de Barbieland est d’habitude relégué au second plan (Où dorme les Kens ? On ne le saura jamais…) Une des meilleures phrases du film est prononcée au passage par un cadre en costume au personnage de Ken qui doute de sa maîtrise du patriarcat : « Ah si, on le maîtrise. Juste, on le cache mieux maintenant ». Et de lui faire un grand sourire.
Alors oui, le film, comme Gerwig, est féministe. On ne saura jamais quelle marge de liberté créative a vraiment été donnée à la réalisatrice mais Barbie dénonce le patriarcat, les doubles standards imposés aux femmes et critique même la position ambiguë de Barbie, qui n’a évidemment pas réussi à sauver les femmes en leur montrant qu’elles « pouvaient tout faire ». Mattel se met en scène comme une boîte entièrement masculine (ce qui sera critiqué une fois, mais n’aura pas bougé d’un pouce à la fin du film), avec à sa tête un Will Ferrell beaucoup trop attachant pour que l’autocritique de la boîte soit honnête.
Barbie reste avant tout une commande et son féminisme rose n’a aujourd’hui rien de révolutionnaire. Ça fait maintenant quelque année qu’on sait qu’on peut être féminine et féministe et même si ça n’est jamais inutile de le rappeler, le sujet est ici plus un décor qu’une vraie position politique.
Ce n’est pas le seul propos du film, qui délivre des messages multiples et souvent pertinents à travers ses dialogues, notamment sur le sujet de la dépression et du burn out au féminin, portés, c’est à noter, par une femme racisée d’une quarantaine d’années qui trouve un réconfort à continuer de jouer et d’inventer autour du personnage de Barbie.
Moi aussi, mes Barbies ont participé à m’apprendre à raconter des histoires.
Un joli fil rouge aurait pu en être tiré, mais le film rate le coche. La pertinence des messages s’étiole au fur et à mesure qu’ils s’accumulent sans être forcément bien traités. Comme le discours caricatural de la petite Sacha qui traite Barbie de “fachiste” et qui pourtant soulève des critiques qui sont pour la plupart légitimes et aurait pu apporter, sans en faire trop, plus de nuances.
Au final, Barbie s’éparpille jusqu’à en devenir confus, à travers beaucoup de grands discours qui ne reposent sur rien de concret, en tout cas dans le film. Le monologue de fin d’America Ferrera, qui dénonce l’impossibilité d’être une femme face aux exigences patriarcales est certes très touchant et bien interprété, mais reste seulement des paroles, libératrices, d’accord, mais jamais illustrées. Pour être plus claire, le film dit plus qu’il ne montre au fur et à mesure qu’il avance. Et avec ça, le personnage de Barbie perd de plus en plus en profondeur.
La fin se concentre sur la reprise de Barbieland par les Barbies face aux (et surtout à un) Kens qui essayent d’y imposer le patriarcat. Une action féminine collective et deux numéros musicaux masculins plus tard, tout rentre dans l’ordre. Et après avoir appris à Ken qu’il devait exister par et pour lui-même, Barbie disparaît dans un halo de lumière blanche et devient humaine.
Elle se présentera alors comme Barbara Handler, nom de la petite fille de Ruth Handler, créatrice de Barbie, qui s’est inspirée d’elle selon la légende pour créer la célèbre poupée et qui apparaît dans le film sous les traits d’une grand mère angélique
Je retrouve la confusion du film dans les yeux de mes ami.es lorsque l’on quitte la salle. Avec beaucoup de sujets traités en surface et une avalanche de références à l’histoire et aux produits Mattel souvent trop appuyées, les ambitions féministes du film se heurtent à son essence de divertissement marketing bien calibré et finalement un peu fourre-tout.
On s’y attendait ! Oui, mais bon. Voir l’écriture et l’intelligence de Gerwig, ainsi que le travail de création plastique de ses collaborateur.ices mises à profit d’un produit finalement très gros sabots est quand même assez déprimant. Le film a peu parlé aux enfants et joue avec des stéréotypes d’adultes qui ne racontent pas beaucoup plus, au final, que ce que les spectateur.ices étaient déjà venus voir. Et ça déclenche chez moi une certaine amertume face aux qualités réelles du film. Un bon divertissement ? Peut-être pas assez.
Je vois le film Barbie comme une métaphore du passage à l’âge adulte. Tout n’est que jeu, jusqu’à l’arrivée du rapport à la mort, des premières désillusions et de la confusion face à la complexité du monde. À la fin, les costumes eux même sont moins enfantins, Barbie porte une robe flottante qui n’est plus cintré à la taille, leurs réactions (sauf celle de Ken qui résiste à cette maturité) sont beaucoup plus nuancées et on apprend qu’il faut accepter que le monde change quand le temps avance et que cette progression est inarrêtable.
Un joli message, que Barbie embrasse en choisissant de se transformer en humaine, de devenir créatrice plutôt qu’objet. Mais problème. Le personnage de Barbie s’est effacé au fur et à mesure du film et son trajet intérieur nous est très peu livré. On ne sait pas profondément ce qui pousse Barbie à devenir humaine, les quelques dernières (et rares) répliques de Margot Robbie restant finalement très floues.
Sous son avalanche de messages qui vont dans tous les sens, le film rate, à mon sens, ses promesses autour de la question de la mortalité et de notre rapport au jeu qui se noient dans les dernière phrase (un peu creuses) du personnage de Ruth. Le message sonne faux et ici, ce n’est plus un jeu.
Ma colère se déclenche quand je vois le montage final de petites filles qui jouent, qui vivent, qui racontent et qui mettent Barbie les larmes aux yeux. C’est peut être ces histoires que le film auraient du raconter. Et il en tire profit. Et il ne les raconte pas.
Et puis il y a un dernier gros problème à aborder. Ken.
Ryan Gosling est très drôle en Ken. Peut-être même trop. Son temps d’écran à la fin du film est hallucinant, surtout en comparaison avec le peu de répliques de Margot Robbie et le personnage, bien que bête, reste très attachant et très divertissant à regarder.
Sa crise existentielle prend beaucoup de place, jusqu’à une apothéose de grimaces et de pleurs déchirants, ridicules, certes, mais au centre du récit. Barbie le console et lui apprend à se relever avant son départ, et c’est Ken que la caméra regarde. C’est son voyage intérieur qui est mis en valeur.
Mine de rien, c’est elle qui s’excuse à la fin, et lui ne fait qu’exprimer de la confusion.
Après un dernier petit monologue de Ryan Gosling, les Kens baissent les armes et la fin est une grande réconciliation. Et suite à ça les choses changeront peu à Barbieland, où il est dit que les Kens obtiendront peut-être un jour “autant de pouvoir que les femmes dans le vrai monde”
L’idée d’en faire un matriarcat, au début réjouissante, donne des excuses à ce (et ces) Kens qui n’arrivent pas à exister par eux-mêmes. Ou en tout cas, on peut le voir comme ça et le film ne prend pas assez de précautions sur ce point à mon sens pour que le danger n’existe pas. On peut percevoir Ken simplement comme une victime qui a voulu inverser les règles du pouvoir.
Même si certaines images ont l’air, dans une ambiance post prise du capitole, de faire référence à des politiques assez nauséabonde (les Kens cherchent à construire un mur pour empêcher l’accès à Barbie – pardon – Kendom…) cette violence-là et très vite éclipsée par les blagues de Ryan Gosling, son numéro musical et le côté (même à la fin et ça pose question) très enfantin des Kens.
Les pauvres, ils ne savent pas ce qu’il font.
Entre ça, et le plan de récupération de Barbieland qui repose sur une séduction et une mise en concurrence des Kens, la fin du film se noie un peu dans les mêmes clichés patriarcaux qu’elle cherchait précisément à dénoncer.
Alors un film à jeter ? Encore une fois non. Pour ses qualités précédemment citées et pour le photomaton culturel qu’il est, Barbie mérite un coup d’œil, en gardant un peu de recul. Je retiendrai, au-delà du film, la communauté enthousiaste qu’il a créée, des bandes d’anciens enfants qui s’habillent sans honte en rose pour aller retrouver au cinéma la poupée qui les a accompagnés. Ça, excusez-moi du terme, déjà, c’est chouette. Mais Barbie a également rassemblé des gens en ligne, permis la création de projets, de discussions, d’œuvres d’art… Le film existait déjà dans nos esprits avant qu’on le voit et ce film imaginaire reste un joli cadeau de début d’année. C’est ce que moi je choisis de retenir du phénomène Barbie en tout cas.
Lou Montesino
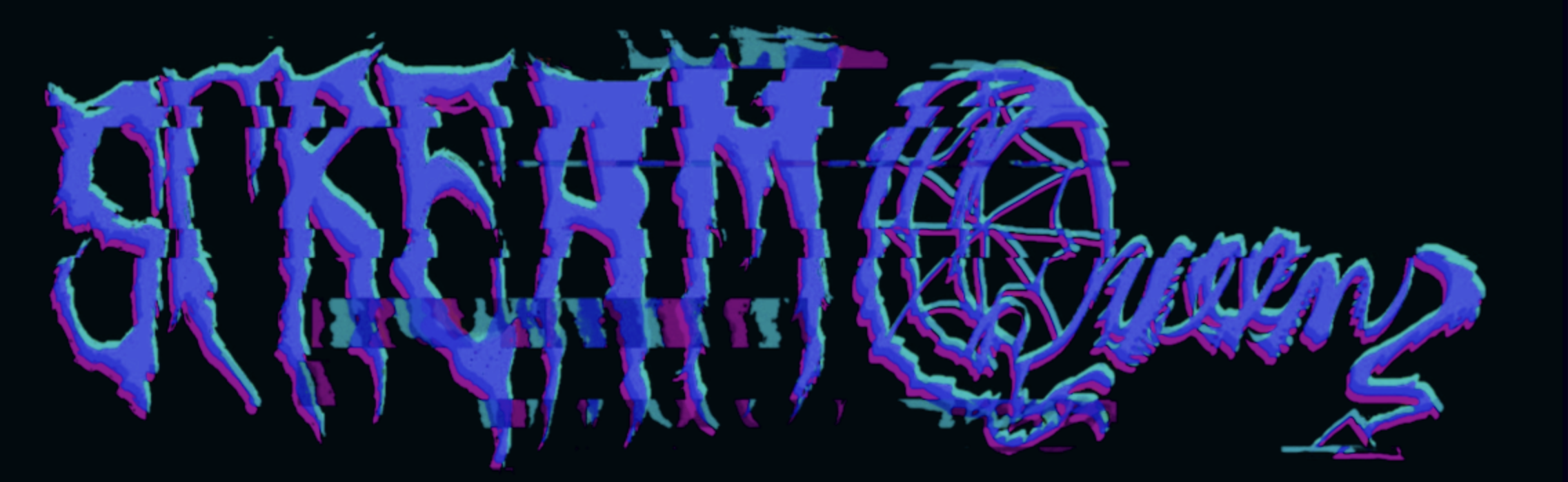
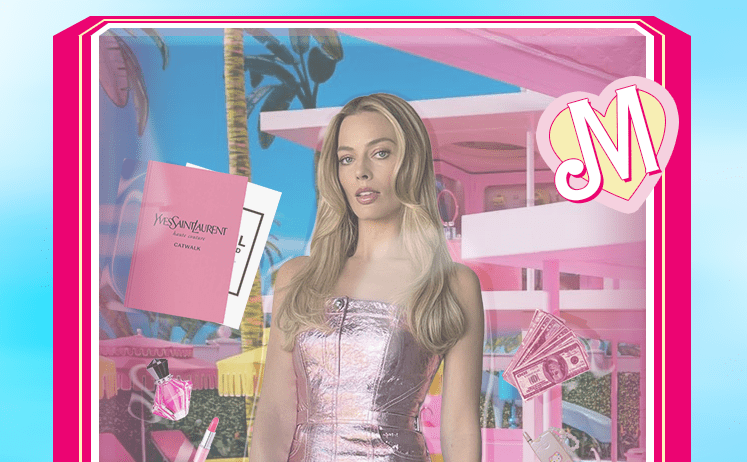
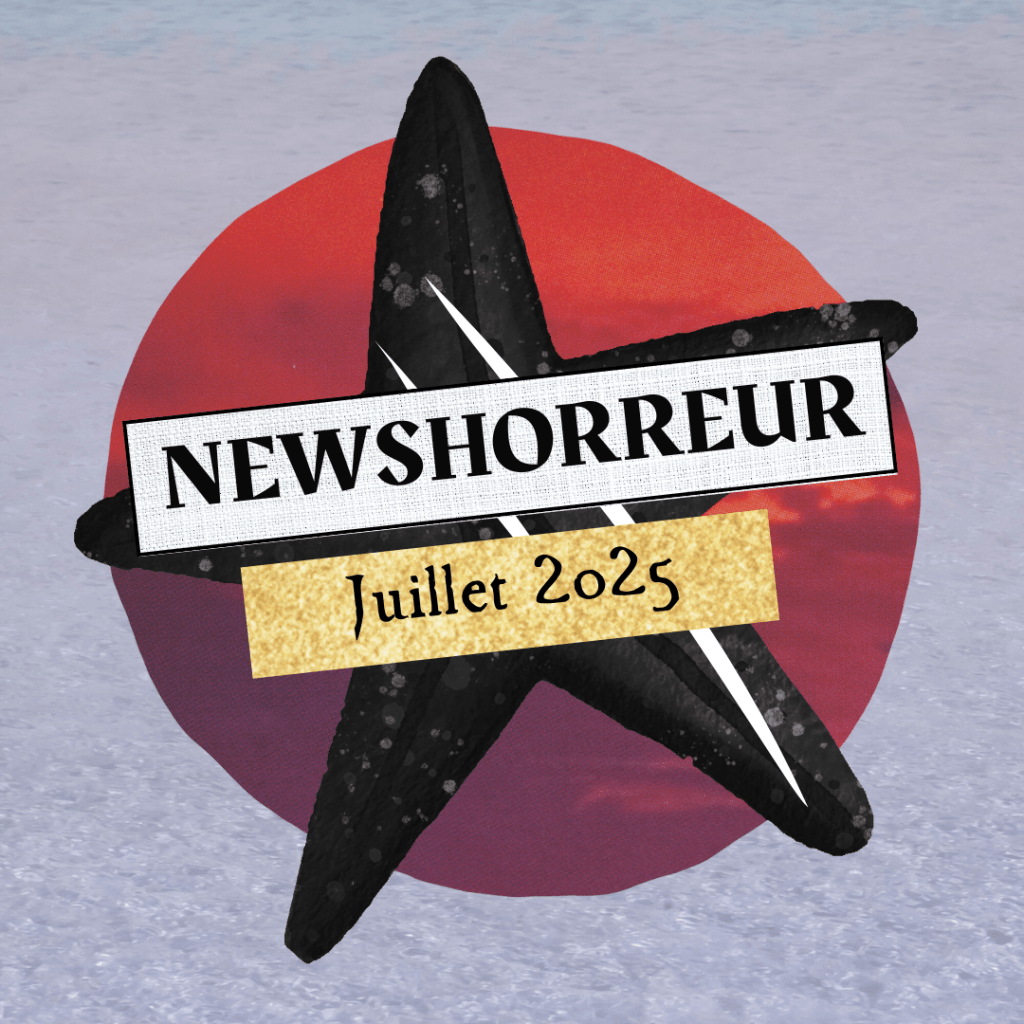
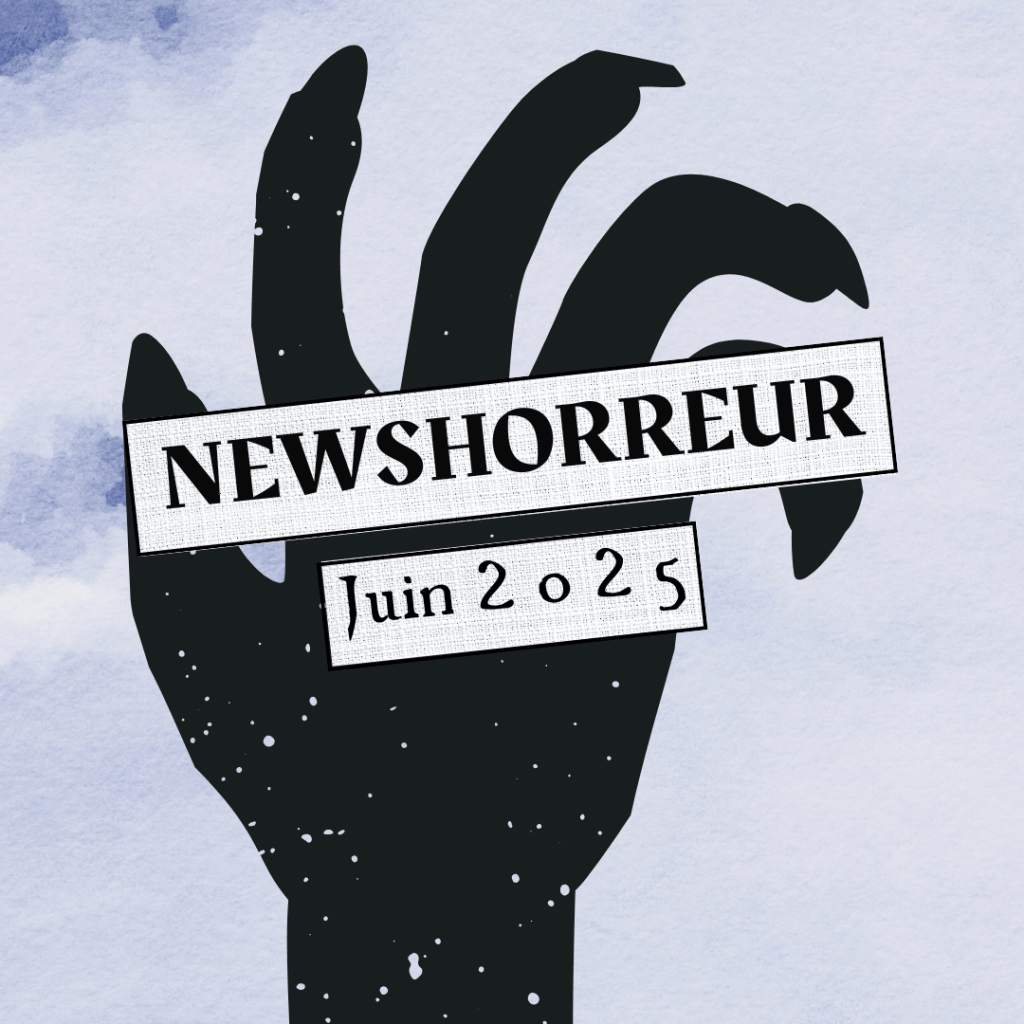
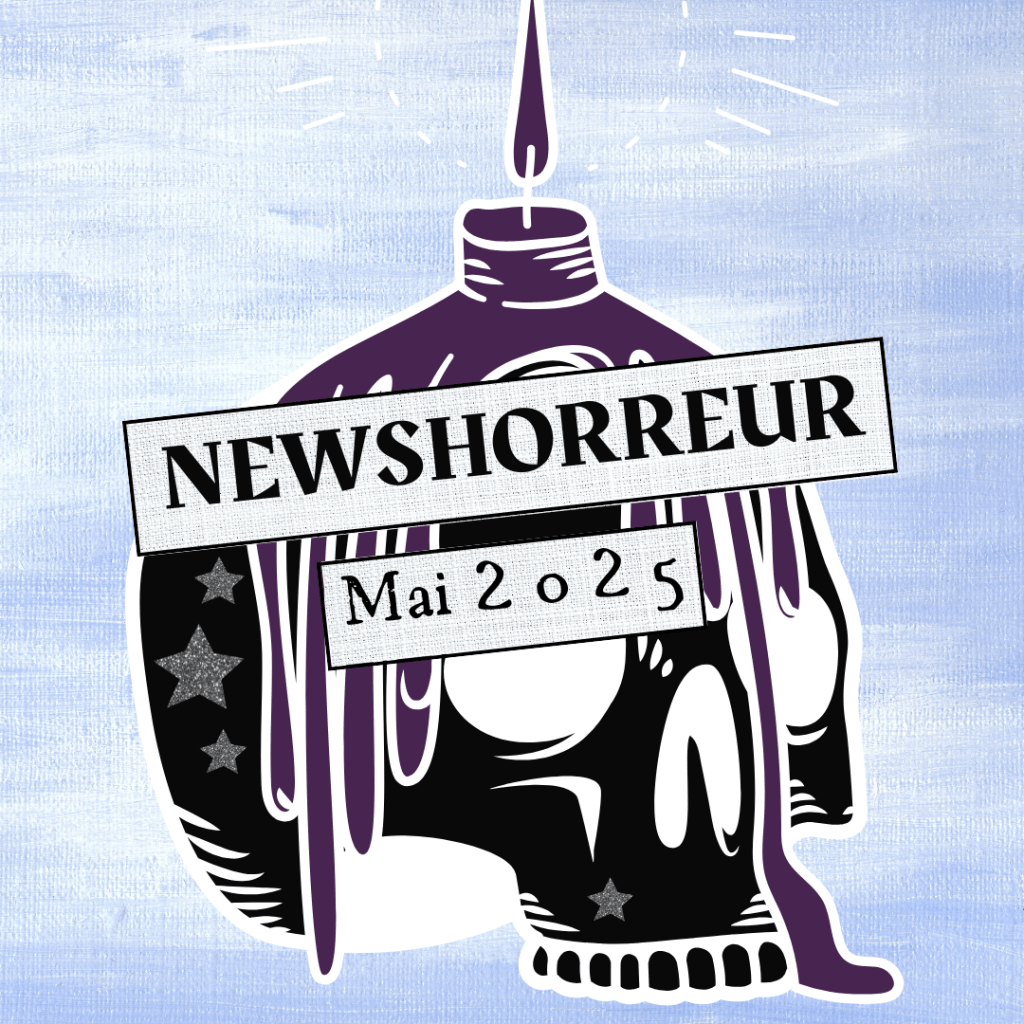
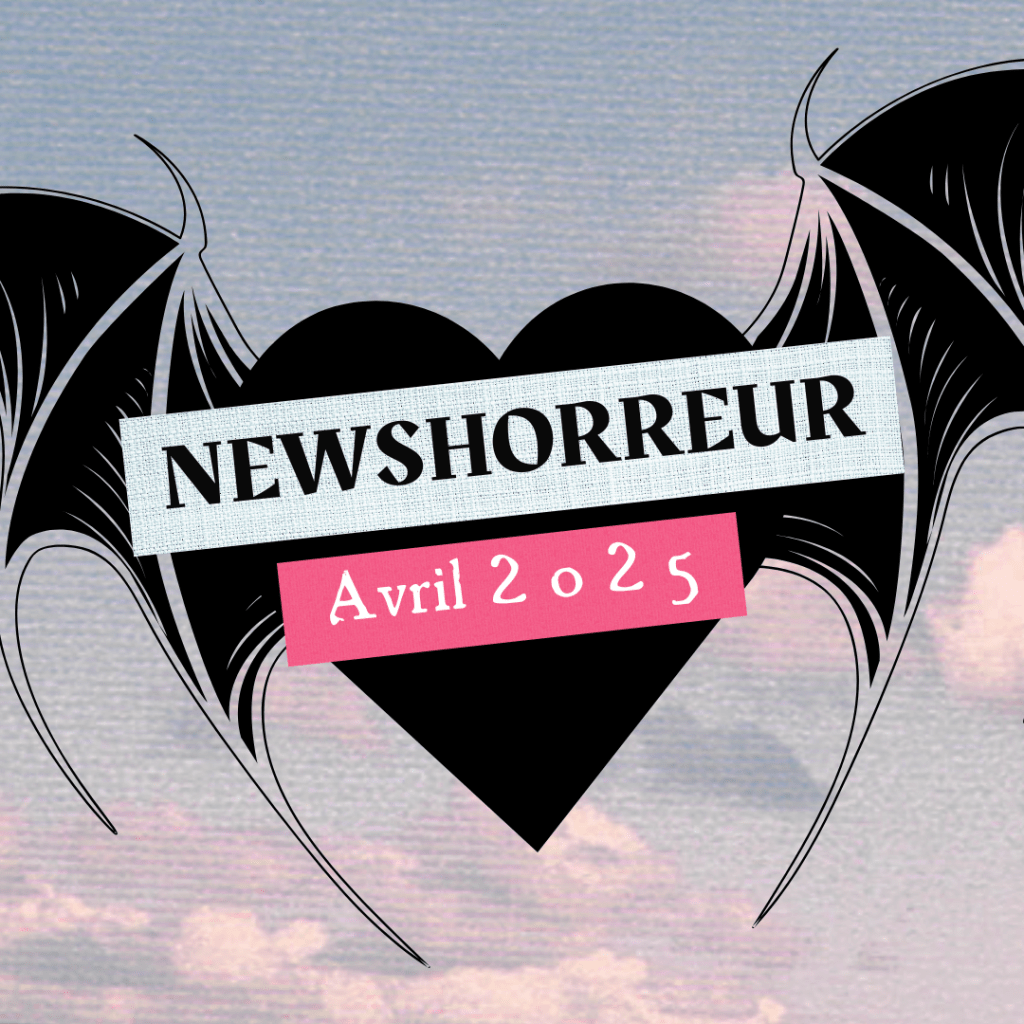
Laisser un commentaire